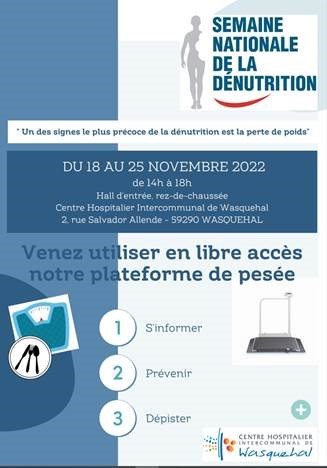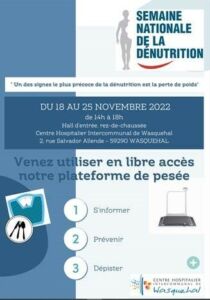Depuis plus de 15 ans, la Haute Autorité de santé (HAS) travaille à impliquer les usagers et leurs représentants en réfléchissant à leur place et leurs contributions dans les productions, les commissions ou les instances de l’institution. De nombreuses évolutions sociétales, dispositions légales, ou encore les crises sanitaires récentes ont suscité en France l’émergence de nouvelles modalités de participation au-delà des mécanismes de représentation des usagers. Pour que chacun puisse intervenir et ainsi transformer les pratiques, la HAS publie de nouveaux travaux pour améliorer encore l’information et la formation des usagers et de leurs associations.
Renforcer la place des usagers dans le système de soins reste un enjeu majeur pour favoriser la démocratie en santé au sens entendu dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a rendu obligatoire la présence de représentants d’usagers au sein des « instances hospitalières et de santé publique ». Il est tout aussi important de renforcer la participation des personnes accompagnées dans le champ social et médico-social, comme l’a instauré la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. C’est d’ailleurs le sens du deuxième axe du projet stratégique 2019-2024 de la HAS : « faire de l’engagement des usagers une priorité ». À ce titre, la HAS organise aujourd’hui la troisième édition de son rendez-vous annuel de l’engagement des usagers et publie deux nouveaux travaux : un guide de coopération entre la HAS et les usagers du système sanitaire, social et médico-social et un outil de formation à la contribution des associations d’usagers au processus d’évaluation des technologies de santé.
Des évolutions majeures imposant une actualisation du guide de coopération avec les usagers
Convaincue de l’importance de l’engagement des usagers dans les prises de décisions de santé qui les concernent, la Haute Autorité de santé a mis en place dès 2008 un cadre de coopération afin d’organiser ses relations avec les associations de patients et d’usagers. Ce cadre posait le principe d’une égalité de traitement entre les professionnels et les usagers impliqués dans ses travaux, reconnaissant à ces derniers le statut d’experts. Une avancée majeure dans la reconnaissance de ce statut qui allait être saluée 3 ans plus tard par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas).
Depuis 2008, diverses évolutions ont été opérées :
- Sur le plan pratique, diverses méthodes ont été mises en place pour renforcer la participation des citoyens que ce soit aux commissions spécialisées, à des groupes de travail et de lecture, à des entretiens individuels ou groupés, à des consultations publiques ouvertes à tous…
- Sur le plan juridique, la charte de l’expertise sanitaire a apporté une distinction entre la qualité des parties prenantes, s’exprimant au nom d’une association dont elles portent le point de vue, et celle des experts, s’exprimant en leur nom propre et participant directement à la production d’une expertise scientifique ; le périmètre d’action de la Haute Autorité de santé a été élargi au secteur social et médico-social ; et depuis le 15 décembre 2021, un règlement européen pose le principe de recueillir l’expertise des « patients atteints de la maladie ».
- Sur le plan stratégique enfin, un conseil pour l’engagement des usagers a été créé et la HAS a fait de leur participation à ses travaux une priorité.
La HAS a décidé d’actualiser et de clarifier les modalités de participation des usagers à ses travaux et de les inscrire dans un nouveau guide de coopération en tenant compte de ces évolutions, notamment il élargit au champ social et médico-social le cadre qui posait les fondements du statut d’usagers experts et précise les degrés d’engagement possibles.
Une reconnaissance de la valeur du statut d’usager-expert
À travers cette démarche, la HAS confirme son engagement à prendre en considération les savoirs expérientiels des usagers dont elle reconnait la valeur. Ce qu’ils apportent est complémentaire des connaissances scientifiques et de l’expérience des professionnels et participe à un meilleur équilibre entre les différentes sources de savoirs : leur vécu de la maladie ou de leur situation de vie de ses contraintes, des modalités de traitement ou d’accompagnement. Grâce à leur implication, les usagers renforcent la démocratie en santé et améliorent la pertinence et l’efficacité des avis, décisions et autres recommandations émises par la HAS.
Partie prenante ou patient-expert : la HAS précise les niveaux d’engagement
Le nouveau guide publié par la Haute Autorité de santé précise le statut selon lequel les usagers peuvent être amenés à participer à ses travaux (en qualité de parties prenantes, c’est-à-dire au nom de l’association qui les aura désignés pour défendre ses intérêts, ou en qualité d’experts, c’est-à-dire en leur nom propre), et les droits et devoirs que chaque statut implique. Les usagers experts doivent ainsi répondre à des critères de compétences, d’expérience et d’indépendance, et, à la différence des parties prenantes, déclarer leurs liens d’intérêts de façon à garantir leur impartialité et leur objectivité. Ils sont indemnisés comme tout autre expert.
La HAS décrit également les différentes modalités de participation des usagers, et les implications qui en découlent. Ils sont amenés à collaborer activement et voter les délibérations comme membre d’une commission, d’un groupe de travail, d’un jury… ; ils peuvent être consultés au cours d’une audition, dans des entretiens de groupe, des consultations publiques, en répondant à des tests utilisateurs… ; leurs associations peuvent saisir la HAS ou conduire des projets en tant que partenaires institutionnels. La HAS indique par ailleurs comment se porter candidat, les compétences utiles (connaissances sur le circuit du médicament, sur une maladie, une situation sociale…), ainsi que les qualités attendues (ouverture d’esprit, respect, art de l’argumentation…). Elle détaille enfin les critères de sélection sur lesquels elle s’appuie pour favoriser la diversité des participants et comment elle adapte ses méthodes de travail aux publics en situation de handicap ou de précarité.
De nouveaux outils pour favoriser l’implication des usagers
- Dans l’évaluation de la qualité des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Plus que jamais soucieuse d’améliorer l’expérience des patients et des personnes accompagnées au sein des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et de la médecine de ville, la HAS rappelle les outils mis en place à cet effet : l’enquête e-Satis (2016) qui recueille leur point de vue sur le parcours de soins après un séjour hospitalier et la participation de représentants d’usagers issus d’associations agréées à la certification des établissements de santé. En 2022, la Haute Autorité de santé a développé l’implication des personnes accompagnées dans l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
- Dans l’évaluation des produits de santé
Les associations de patients et d’usagers disposent désormais d’une formation en ligne qui leur permettra de comprendre ce que la HAS attend de leur contribution et ainsi de s’impliquer plus nombreux et plus souvent dans l’évaluation des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes professionnels. Ce nouvel outil conçu par la Haute Autorité de santé est accessible en ligne sous forme de diaporama et contient toutes les informations relatives à l’évaluation des technologies de santé et aux modalités de participation des usagers. Cet outil pourra être utilisé individuellement ou collectivement : une association pourra ainsi l’utiliser comme support à une formation grâce à des diapositives simples et imagées ainsi que des informations et références complémentaires accessibles en ligne dans la partie « notes de diapositives » et des liens vers des documents publics accessibles en ligne. Un quiz sous forme d’auto-évaluation permet ensuite de tester ses connaissances.
- Dans l’élaboration de recommandations pour les professionnels du secteur social et médico-social
Afin de renforcer la contribution des personnes accompagnées à l’élaboration des recommandations de bonne pratique pour le secteur médico-social, la HAS a expérimenté différentes méthodes de participation, par exemple lors de ses travaux sur l’accompagnement des personnes atteintes d’un trouble du développement intellectuel. Elle a formalisé ces méthodes dans un guide et les a déclinées dans un document d’information spécifiquement destiné aux personnes concernées et à leur entourage.